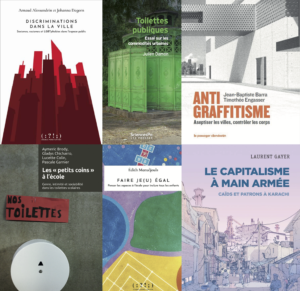Lu / Le capitalisme à main armée. Caïds et patrons à Karachi, Laurent Gayer
Mikayil Tasdemir
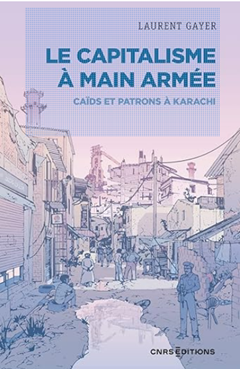 Cet ouvrage de Laurent Gayer, chercheur en sciences politiques au CNRS et affilié au CERI Sciences Po, se penche sur la genèse de la prédation au sein des chaînes de production, soit la manière dont les patrons se sont dotés de méthodes coercitives afin d’assurer un contrôle total sur les travailleurs au travers des ressorts capitalistiques. Ce travail s’inscrit dans le sillage du travail mené par Chomsky et Waterstone sur la corrélation entre avènement du capitalisme et épisodes tragiques (coups d’État, militarisme…). Son expertise réside dans l’étude de la violence politique en Asie du Sud, et notamment au Pakistan, pays délimité par l’Inde à l’est, l’Afghanistan et l’Iran à l’ouest, la Chine au nord, et qui possède une côte maritime au sud s’ouvrant sur la mer d’Arabie et le golfe d’Oman. Dans cet ouvrage, Le Capitalisme à main armée, caïds et patrons à Karachi, (2023), l’auteur révèle les dispositifs inhérents au capitalisme croissant dans la capitale pakistanaise. Cette monographie propose une analyse comparative entre la chaîne de production et la chaîne de prédation en neuf chapitres, détaillant la manière dont « l’avènement d’un ordre productif repos[e] dans sa globalité sur le contournement des contraintes réglementaires » (p. 13). Elle offre une étude approfondie des acteurs (patrons, militaires, groupes armés) et de leurs méthodes (surveillance, corruption). Bien que centrée sur le cas pakistanais, des références sont faites à d’autres contextes mondiaux, comme les États-Unis ou l’Amérique Latine, pour éclairer la situation à Karachi.
Cet ouvrage de Laurent Gayer, chercheur en sciences politiques au CNRS et affilié au CERI Sciences Po, se penche sur la genèse de la prédation au sein des chaînes de production, soit la manière dont les patrons se sont dotés de méthodes coercitives afin d’assurer un contrôle total sur les travailleurs au travers des ressorts capitalistiques. Ce travail s’inscrit dans le sillage du travail mené par Chomsky et Waterstone sur la corrélation entre avènement du capitalisme et épisodes tragiques (coups d’État, militarisme…). Son expertise réside dans l’étude de la violence politique en Asie du Sud, et notamment au Pakistan, pays délimité par l’Inde à l’est, l’Afghanistan et l’Iran à l’ouest, la Chine au nord, et qui possède une côte maritime au sud s’ouvrant sur la mer d’Arabie et le golfe d’Oman. Dans cet ouvrage, Le Capitalisme à main armée, caïds et patrons à Karachi, (2023), l’auteur révèle les dispositifs inhérents au capitalisme croissant dans la capitale pakistanaise. Cette monographie propose une analyse comparative entre la chaîne de production et la chaîne de prédation en neuf chapitres, détaillant la manière dont « l’avènement d’un ordre productif repos[e] dans sa globalité sur le contournement des contraintes réglementaires » (p. 13). Elle offre une étude approfondie des acteurs (patrons, militaires, groupes armés) et de leurs méthodes (surveillance, corruption). Bien que centrée sur le cas pakistanais, des références sont faites à d’autres contextes mondiaux, comme les États-Unis ou l’Amérique Latine, pour éclairer la situation à Karachi.
Cette recherche exhaustive menée de 2015 à 2022 comprend sept mois de terrain non consécutifs, 160 entretiens diversifiés et l’analyse d’un fonds d’archives substantiel des États-Unis et du Royaume-Uni. Elle se concentre principalement sur les mécanismes liés à l’industrie textile, point de départ du processus d’industrialisation pakistanaise. Ce secteur, marqué par des illégalismes et un modèle managérial patriarcal, est examiné aux côtés de l’industrie pharmaceutique. Chaque secteur est exploré à travers le prisme de deux entreprises, cherchant à répondre à la question « de quoi le capitalisme industriel de Karachi et ses modes de contrôle sont-ils vraiment un cas ? » (p. 32) afin d’en déterminer l’organisation verticale de la prédation, des patrons sur les ouvriers.
L’ouvrage interroge la portée tentaculaire du capitalisme, en examinant ses acteurs et ses manifestations. Il explore également la dimension géographique de ce phénomène, soulignant son expansion au-delà des zones industrielles jusque dans les quartiers et les logements des ouvriers. De même, il aborde la question de la place des luttes syndicales, notamment dans leur dimension spatiale. L’évolution des modes d’action du capital au sein du système productiviste est analysée à travers les mutations politiques au fil de l’histoire. Ce faisant, il interroge l’impact du capitalisme industriel sur la dynamique socio-spatiale de Karachi, en mettant en lumière les interactions entre acteurs économiques, sécuritaires et juridiques, et leur influence sur les conflits urbains et les rapports de pouvoir locaux.
–
La mise en place du capital : histoire et acteurs de la répression
L’étude des illégalismes industriels sous un prisme foucaldien met en lumière la tolérance des instances étatiques envers des pratiques illicites, parfois plus influente que les interventions directes (Foucault, 1993). Les années Zia-ul-Haq (1978-1988) ont connu un tournant vers la libéralisation, l’autoritarisme et l’islamisation, engendrant l’émergence d’une élite politique et le désamour des travailleurs pour la vie politique, impulsé par le gouvernement (p. 106). Le capitalisme de connivence dans les années 80 a été marqué par des compromis entre grandes entreprises et acteurs bureaucratiques, politiques et militaires. La transition du modèle familial et patriarcal vers un modèle bureaucratique est notable, bien que le pouvoir et le capital restent en grande partie aux mains de la famille. Ces transformations étatiques n’ont pas mis fin à l’ordre patronal mais ont perpétué le capitalisme à Karachi en engendrant un pluralisme coercitif.
Une corrélation entre transformation de l’État et capitalisme
L’histoire du Pakistan révèle que le développement industriel et l’évolution de l’État sont allés de pair. Dès 1959, lors d’une conférence internationale cruciale, la question syndicale se pose au moment où le pays s’engage dans une industrialisation rapide sous l’égide d’un développementalisme autoritaire. Cette période est marquée par un parti-pris déterminant en matière économique : une priorité au financement de la guerre plutôt qu’au bien-être, créant ainsi ce que l’auteur appelle « économie de la sécurité » (p. 88) Cette politique vise à assurer la paix industrielle en favorisant la sécurité, sacrifiant ainsi les luttes syndicales sur l’autel de la stabilité et du développement économique. Cette sécuritisation du développement économique découle des périodes chaotiques qui ont caractérisé les premières années du Pakistan :
« Loin de contraindre l’Etat pakistanais à faire des concession à la société, l’emphase placée sur la sécurité nationale et les conflits ouverts qui ont ponctué l’histoire du pays (1948, 1965, 1971, 1999) ont au contraire conduit ses gouvernants à sacrifier toute velléité de protection sociale » (p. 93)
Les répressions des leaders syndicaux ont marqué cette dynamique, érigeant une économie mixte de la sécurité, où les détenteurs du capital ont fusionné leurs intérêts avec des professionnels de la coercition. Même après les tentatives de création d’un État social sous Bhutto, cette approche a été consolidée par le coup d’État militaire de 1977, mettant fin à toute velléité de protection sociale. Dans ce contexte, les « entrepreneurs de violence » (Blok, 1974 ; Volkov, 2000) jouent un rôle crucial. Le capitalisme industriel au Pakistan s’est approprié deux paradigmes : la défense de l’ordre patronal confiée aux acteurs locaux (« à ce titre, les industriels peuvent compter sur le plein soutien des autorités » (p. 90)) et la délégation à des agences entrepreneuriales de violence spécialisées. Ces contractors ont prospéré depuis les années 1980, surtout dans les secteurs textiles et pharmaceutiques, exploitant des travailleurs précaires tout en maintenant un ancrage local dans les quartiers ouvriers.
Une perspective comparative enrichit cette analyse portant notamment sur l’Indonésie et les États-Unis, où des formes similaires de mercenariat antisyndical ont émergé. Cette stratégie, confondant la défense du capital avec le droit à l’autopréservation (p. 50), a façonné le modèle de développement et les rapports entre les acteurs industriels, l’État et les travailleurs au Pakistan. Les dynamiques sécuritaires et les pratiques antisyndicales révèlent l’emprise du capitalisme sur la gouvernance étatique, mettant en lumière la nécessité d’une analyse approfondie des interactions complexes entre ces deux sphères.
Des acteurs variés à l’œuvre pour contraindre et réprimer
L’accident survenu dans une usine de Baldia Town1 révèle la structure de l’ordre productif, où le contournement des contraintes réglementaires est central. Laurent Gayer observe une « rechute » prédatrice à la fin du XXe siècle, exacerbée par les conflits internationaux et l’impunité accordée aux élites délinquantes. Le parallèle avec la manifestation devant l’usine Ford à Detroit en 1932 souligne l’escalade de la violence avec l’intervention de la police d’État et de la police privée. Cette période marque le début du contrôle exercé par des informateurs et les nervis (« le Service Department est la plus puissante police privée du monde », p. 35), donnant naissance à de puissants services de police privée. Le répertoire d’action comprend le contrôle social, l’espionnage et l’intimidation physique :
« ce répertoire répressif éclaire l’histoire du capitalisme mais aussi la formation de l’Etat (…) il met en lumière des jeux d’alliance volatiles entre professionnels et amateur du maintien de l’ordre, ainsi que des connivences plus structurelles, découlant de l’enchevêtrement entre défense de l’ordre productif et préservation de l’ordre politique. » (p. 36-37)
Les militaires, en particulier les fauji2, exercent une influence significative, notamment à partir des années 1990, malgré leur présence antérieure, à travers un système de protection privée qu’ils dominent et les forces de l’ordre patronal, telles que les jobbers et les supervisors, constituent un appareil disciplinaire interne, possédant des pouvoirs non seulement liés à l’organigramme, mais aussi à la capacité de recruter et licencier des employés. D’autres figures, comme les dadas et chowkidar, représentent l’appareil de sécurité privé, participant au maintien de l’ordre économique. Néanmoins, le chapitre 8 interroge la loyauté et la probité de ces acteurs, mettant en lumière le malaise des nouveaux citadins venus des espaces ruraux et la pratique compulsive du profilage, corrélée à la peur croissante de représailles de la part de l’appareil répressif. L’augmentation du nombre d’agents de sécurité privée par rapport aux policiers en service montre une « domination inquiète » (p. 344) de la part des élites économiques, soulignant les complexités et les tensions de ce système de maintien de l’ordre capitalistique.
–
Du site industriel à la ville : un terrain de lutte(s) étendu
L’usine, un espace de travail, de lutte syndicale et de répression
L’usine est un prisme révélateur des enjeux du capitalisme industriel à Karachi. Le chapitre 9, « L’épreuve du feu », ainsi que l’introduction, se focalisent sur l’accident tragique de Baldia Town. Cet événement traduit l’organisation du travail industriel, avec ses irrégularités et l’utilisation de la coercition à travers le recrutement de nervis. Il souligne également la manière dont le droit est pris dans une spirale de conflits propre au « désordre ordonné » (p. 387) généré par le capitalisme. La difficulté à attester des rôles et des responsabilités dans de tels accidents entrave les efforts militants pour en faire un scandale médiatique et inciter au changement, et, dix ans après l’accident, seulement 15 % des ouvriers ont accès à des issues de secours, illustrant les lacunes persistantes en matière de sécurité. L’histoire des mouvements antisyndicaux est également explorée, témoignant de la perte de force du syndicalisme à partir des années 70. La flexibilisation du travail ouvrier dès les années 1980, visant à réduire les coûts et reposant sur la force et la fraude, a également découragé ce syndicalisme. Ce chapitre met aussi en évidence le rôle crucial de la police industrielle dans la répression des mouvements syndicaux, un phénomène rappelant l’histoire des mouvements antisyndicaux aux États-Unis. En fin de compte, les pratiques antisyndicales et répressives des employeurs, souvent défendues au nom de la préservation de l’entreprise comme champ social autonome, révèlent les tensions inhérentes au capitalisme industriel à Karachi. Les « prophylaxies sociales » (p. 193) mises en œuvre par les industriels visent à maintenir un certain ordre et à protéger leurs intérêts dans un contexte où la lutte syndicale et les mouvements ouvriers sont entravés par des pratiques coercitives et des lacunes dans le système légal. L’usine, non plus seulement un espace de travail, devient un espace de luttes, de répressions et de découragement pour les mouvements protestataires – une triple dimension largement abordée dans l’ouvrage de Laurent Gayer.
De l’usine à la ville : l’incarnation du capitalisme à main armée tentaculaire
L’incarnation du capitalisme à main armée à Karachi se révèle à travers l’analyse des conflits urbains et des rapports de pouvoir entre les acteurs économiques, sécuritaires et juridiques. Depuis les années 1980, la ville est marquée par des épisodes violents, perturbant son économie locale avec des activités commerciales et industrielles ciblées. Le MQM, acteur politique majeur, a utilisé le hartal, journée de grève générale avec violences depuis le milieu des années 90, pour exercer une pression et obtenir des concessions, souvent avec l’appui tacite des autorités. En parallèle, les contractors, intermédiaires entre les patrons et les ouvriers, jouent un rôle crucial en exploitant les sociabilités villageoises et les castes à leur avantage, tout en contribuant à la défense des prolétaires et « ces contractors restent profondément insérés à la vie économique et sociale des quartiers populaires. Les enfants apprennent à les craindre et à les respecter » (p. 163). L’ethnicisation de la vie politique a aussi profondément marqué Karachi depuis les années 1980. Des partis structurés sur une base ethnique ont ancré les enjeux locaux dans les quartiers ouvriers, créant ainsi une compétition pour les ressources et l’emploi. Ces dynamiques ont amené les entrepreneurs à ajuster la division ethnique du travail pour restaurer l’ordre usinier, ce qui a entraîné des répercussions significatives sur la géographie de la ville et sur le marché du travail, favorisant une main-d’œuvre considérée comme plus docile par les employeurs. Les conflits urbains ont donné lieu à des réponses entrepreneuriales, favorisant de nouvelles opportunités d’accumulation et de contrôle social pour les élites industrielles de Karachi. Les spécialistes de la coercition ont trouvé un terrain propice pour prospérer, offrant protection et immunisation contre la violence. Les conflits ont justifié une législation antiterroriste visant à maintenir la paix industrielle, renforçant les capacités répressives patronales et renforçant les interdépendances entre détenteurs du capital et professionnels de la violence. La cartographie, notamment par le CPLC3, permet de « rendre plus lisibles des confins urbains dont les industriels sont toujours demeurés peu familiers en dépit de leur contiguïté avec le monde usinier » (p. 302). Le capitalisme industriel à Karachi est in fine façonné par les conflits urbains, les interactions entre les acteurs économiques, sécuritaires et juridiques, ainsi que par les rapports de pouvoir. Cependant, il est essentiel de ne pas surestimer le potentiel émancipateur de ces désordres, car ils ont souvent profité aux acteurs patronaux, offrant de « nouvelles opportunités d’accumulation et de contrôle social aux élites industrielles de Karachi » (p. 226).
–
Conclusion
L’examen approfondi des divers éléments abordés par Laurent Gayer l’amène à conclure que le capitalisme industriel au Pakistan est un système complexe où l’ordre productif repose souvent sur le contournement des régulations. L’analogie entre défenseurs du statut et chasseurs-guerriers (Veblen, 1889), proposée par certains chercheurs, éclaire l’évolution du capitalisme. Dans ce contexte, la contestation sociale ouvre des marges d’impunité au patronat, remettant en question l’idée du recul de la coercition physique au profit de sanctions bureaucratiques. Les fauji, les forces de l’ordre patronal, et les agents de sécurité privée jouent des rôles clés dans le maintien de cet ordre capitaliste. Malgré les spécificités de chaque acteur, tous participent à une forme de stabilité socio-économique, parfois au détriment des droits des travailleurs. Il devient ainsi essentiel de réfléchir à des réformes qui préservent l’équité sociale tout en tenant compte des impératifs économiques, pour envisager un système plus équilibré et juste dans le contexte du capitalisme pakistanais. Si les termes employés par l’auteur pour parler de certains groupes d’acteurs spécifiques ne sont pas évidents à la première lecture, le public visé par l’auteur semble assez large puisque la compréhension de l’ouvrage n’en est pas aride pour autant – et le spécialiste, quant à lui, pourra se plonger dans les détails proposés au fil du texte, fruits d’un long travail d’investigation par Laurent Gayer.
MIKAYIL TASDEMIR
Mikayil Tasdemir est normalien-étudiant à l’École Normale Supérieure de Paris. Ses recherches portent sur la modélisation en Géographie.
mikayil.tasdemir@ens.psl.eu
–
Bibliographie
Blok A., 1974, The Mafia of A Sicilian Village, 1860-1960: A Study of Violent Peasant Entrepreneurs. Harper, 293 p.
Chomsky N., & Waterstone, M., 2021, Les conséquences du capitalisme : Du mécontentement à la résistance, Lux Éditeur, 452 p.
Foucault M., 1993, Surveiller et punir, Gallimard, 362 p.
Veblen T., 2007 [1889], The Theory of the Leisure Class, New York, Oxford University Press, 263 p.
Volkov V., 2000, « Les entreprises de violence dans la Russie postcommuniste. », In J.-L. Briquet (Ed.), Politix, 13(49), 57-75.
Référence de l’ouvrage : Gayer L., 2023, Le capitalisme à main armée. Caïds et patrons à Karachi, Paris, CNRS, coll. « Logiques du désordre », 416 p., ISBN : 978-2-271-14553-6.
Couverture : © Jernej Furman, 2023 (Licence CC)
Pour citer cet article : Tasdemir M., 2025, « Le capitalisme à main armée. Caïds et patrons à Karachi, de Laurent Gayer », Urbanités, Lu, mars 2025, en ligne.
–
- En 2012, un incendie criminel dans une usine de vêtements à Baldia Town, Karachi, a tué au moins 258 travailleurs, et une enquête ultérieure a révélé que le MQM (Mohajir Qaumi Movement) avait allumé le feu pour extorquer de l’argent aux propriétaires de l’usine, tandis que des issues bloquées ont exacerbé les pertes humaines. [
]
- Militaires retraités, craints et dont l’autorité est très assumée ; la loi martiale (1958-1962) prévoyait d’ailleurs de lourdes sanctions pénales en cas d’attaque contre un fauji. [
]
- Citizens Police Liaison Committee. [
]